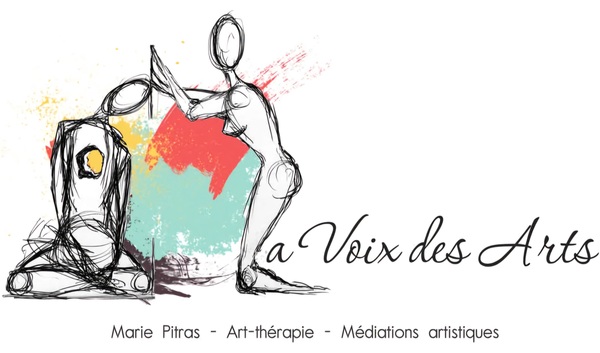Le dialogue invisible : Transfert et contre-transfert en art-thérapie
Dans le sanctuaire de l’atelier d’art-thérapie, il se joue bien plus qu’une simple rencontre entre un thérapeute et une personne en quête de sens. Sous les couleurs, les formes et les gestes, un dialogue invisible se tisse — celui des émotions, des attentes et des histoires anciennes qui cherchent à se dire autrement. C’est dans cette zone subtile que prennent corps deux phénomènes essentiels, hérités de la psychanalyse mais magnifiés par la création : le transfert et le contre-transfert.
Comme l’écrit Jean-Pierre Royol, l’une des spécificités fondamentales de l’art-thérapie réside dans sa capacité à rendre visible l’inconscient, à lui offrir une forme tangible, partageable et transformable. Ce qui, dans la parole, resterait indicible ou fuyant, prend ici corps dans la matière. C’est précisément là que le transfert et le contre-transfert deviennent des leviers de transformation puissants.
Le transfert : quand le passé rejoue sa partition dans la création
Le transfert désigne ce mouvement inconscient par lequel une personne projette sur son thérapeute des émotions, des attentes et des représentations issues de ses relations passées — souvent avec des figures d’attachement ou d’autorité. C’est comme si un ancien film relationnel se rejouait sur un écran neuf : celui du lien thérapeutique.
En art-thérapie, cette projection ne se limite pas à la relation directe avec le thérapeute : elle se matérialise dans l’œuvre. Les formes, les couleurs, les choix de matériaux, la manière de s’en saisir ou de s’en détourner — tout devient langage.
Quelques exemples :
- Une figure parentale peut réapparaître dans un dessin ou une sculpture, traduisant une attente de reconnaissance ou une colère refoulée.
- Une résistance à utiliser certaines matières peut refléter la peur de la perte de contrôle ou de la fusion.
- Une urgence à créer ou, au contraire, une inhibition totale face à la feuille blanche, peuvent signaler un conflit interne transféré sur l’acte créatif lui-même.
L’œuvre agit alors comme un tiers symbolique — ce que Jean-Pierre Royol nomme un espace de déposition. Le patient y dépose ses affects, les rend visibles et partageables. Ce processus d’objectivation ouvre un champ de conscience : on ne subit plus ses émotions, on peut les regarder.

Le contre-transfert : la résonance du thérapeute, miroir et boussole
Face à ce mouvement, le thérapeute n’est pas un écran neutre. Le contre-transfert désigne ses propres réactions émotionnelles, conscientes ou inconscientes, en réponse à ce que la personne lui projette. Ce peut être une résonance affective, un ressenti corporel, une image mentale soudaine ou même une émotion paradoxale (ennui, agacement, tendresse…).
Loin d’être un écueil, ce contre-transfert — lorsqu’il est reconnu, analysé et supervisé — devient un instrument de compréhension fine. Jean-Pierre Royol le décrit comme une boussole interne du thérapeute : il guide la lecture du processus, souvent avant même que le patient puisse en parler.
L’art-thérapeute formé apprend à distinguer ce qui lui appartient de ce qui est révélé par la relation. C’est là tout l’intérêt de la supervision régulière : permettre au praticien de transformer ses propres échos émotionnels en outils d’analyse et d’ajustement. Cette vigilance relationnelle protège le cadre et renforce la qualité du lien thérapeutique.

Une alchimie créatrice : quand relation et création se transforment mutuellement
Transfert et contre-transfert ne sont pas des obstacles à éviter, mais des phénomènes vivants à observer et à travailler. En art-thérapie, ils deviennent les moteurs du processus de symbolisation et de transformation.
- Objectivation : l’œuvre rend visible l’invisible. Ce qui se joue entre deux personnes devient une trace concrète, accessible à la conscience.
- Réflexivité : en observant ensemble ces mouvements, le patient reconnaît ses schémas relationnels et peut commencer à les modifier.
- Réparation : le cadre bienveillant et créatif de l’atelier permet de rejouer autrement ces anciennes scènes intérieures, d’y apporter une fin nouvelle, apaisée.
- Création de sens : en se réappropriant son pouvoir de créer, la personne découvre qu’elle peut aussi recréer sa manière d’être en lien.
L’art, dans ce contexte, devient un tiers thérapeutique, un espace où l’inconscient trouve une voie d’expression symbolique et où le dialogue entre patient et thérapeute se fait plus juste, plus profond.

Quand l’invisible devient visible
En art-thérapie, le transfert et le contre-transfert sont les fils invisibles qui relient le monde intérieur du patient à celui du thérapeute. Grâce à la médiation artistique, ces fils cessent d’être des pièges inconscients pour devenir des voies de transformation consciente.
Là où la parole s’interrompt, la création parle. Là où les émotions débordent, la matière accueille. Et dans cet espace partagé, le regard du thérapeute — à la fois témoin, miroir et passeur — accompagne la personne vers une rencontre plus apaisée avec elle-même.
Comme le rappelle Jean-Pierre Royol :
“L’art-thérapie est le lieu où le psychique se fait visible et partageable. Elle ouvre la possibilité d’un dialogue entre le moi, l’autre et l’œuvre, dans un espace de transformation symbolique.”

Références bibliographiques
- 🌿 Les bases de l’art-thérapie
Jean-Pierre Royol (2013), Art-thérapie : Le souffle du neutre, Profacom / L’Harmattan.
→ Une réflexion profonde sur la neutralité active du thérapeute : être présent, sans envahir.
Le contre-transfert y est envisagé comme un outil sensible, pas comme une gêne.
Jean-Pierre Royol (2017), Art-thérapie : Au fil de l’éphémère, Profacom.
→ Sur la temporalité du transfert : comment la rencontre créative transforme, puis s’efface.
Une belle approche du lien thérapeutique comme œuvre éphémère partagée.
🧩 Les grands textes psychanalytiques
Sigmund Freud (1912), La dynamique du transfert, in La technique psychanalytique, PUF.
→ Le texte fondateur. Freud y pose les bases du transfert comme répétition et mise en acte dans la cure.
Paula Heimann (1950), On counter-transference, International Journal of Psycho-Analysis.
→ Première à reconnaître que le contre-transfert peut devenir un véritable instrument clinique.
Les émotions du thérapeute deviennent des indicateurs du monde interne du patient.
Heinrich Racker (1957), The meanings and uses of counter-transference, Psychoanalytic Quarterly.
→ Il distingue deux formes de contre-transfert : concordant (on ressent ce que vit le patient) et complémentaire (on joue un rôle dans sa dynamique inconsciente).
Donald W. Winnicott (1969), Jeu et réalité, Gallimard.
→ À travers la métaphore du miroir maternel, Winnicott montre que le transfert s’enracine dans la capacité à être vu, accueilli, contenu.
Wilfred R. Bion (1962), Learning from Experience, Heinemann.
→ Le transfert comme matière brute à transformer : le thérapeute aide à rendre “pensable” ce qui ne l’était pas encore.
Didier Anzieu (1985), Le Moi-peau, Dunod.
→ Le transfert y est vécu au niveau du corps et de la peau psychique.
Une lecture essentielle pour comprendre la contenance émotionnelle en art-thérapie.